
L’hiver est le temps de prédilection pour « travailler » le cochon.
Alors le week-end dernier, c’était la saint-cochon.
La saint-cochon, c’est le jour où l’on sacrifie le porc.
Je vous épargne les photos du sacrifice de Monsieur. Oui, on l’appelle Monsieur, parce qu’on est très respectueux de cet animal. Et parce qu’on sait ce qu’on lui doit.
Il y a encore peu de temps, dans les campagnes, chaque foyer élevait son cochon. Un seul. Mais il permettait d’avoir de la viande pour une bonne partie de l’année. Rien d’industriel là-dedans : du temps, du savoir-faire, et une forme d’autonomie très concrète.
Aujourd’hui, pendant qu’on parle du Mercosur, de mondialisation et d’accords commerciaux, ce cochon-là n’a parcouru que dix kilomètres.

Dix !
Oui, on peut consommer local. Pour beaucoup de choses, en tout cas.
Bon, évidemment, si on aime le chocolat ou les bananes, ça va être plus compliqué. Mais pour la majorité des produits, c’est possible. Et quand on tue un goret de 150 kg, on ne plaisante pas : on peut faire pas mal de cochonnaille.










Bien sûr, il y a la viande : côtelettes, rôtis, et cetera.
Mais aussi les saucisses de Toulouse, les chipolatas.
Et toute la salaison : saucissons secs, saucissons à l’ail, lard, pancetta, coppa.
Et puis, si on est un peu courageux – et un peu patient – on peut même faire son propre jambon blanc. Au torchon, évidemment. Un jambon blanc qui ne sera pas rose, bien entendu. Mais quel bonheur de goûter ses propres produits, de savoir exactement ce qu’il y a dedans, et d’où ça vient.
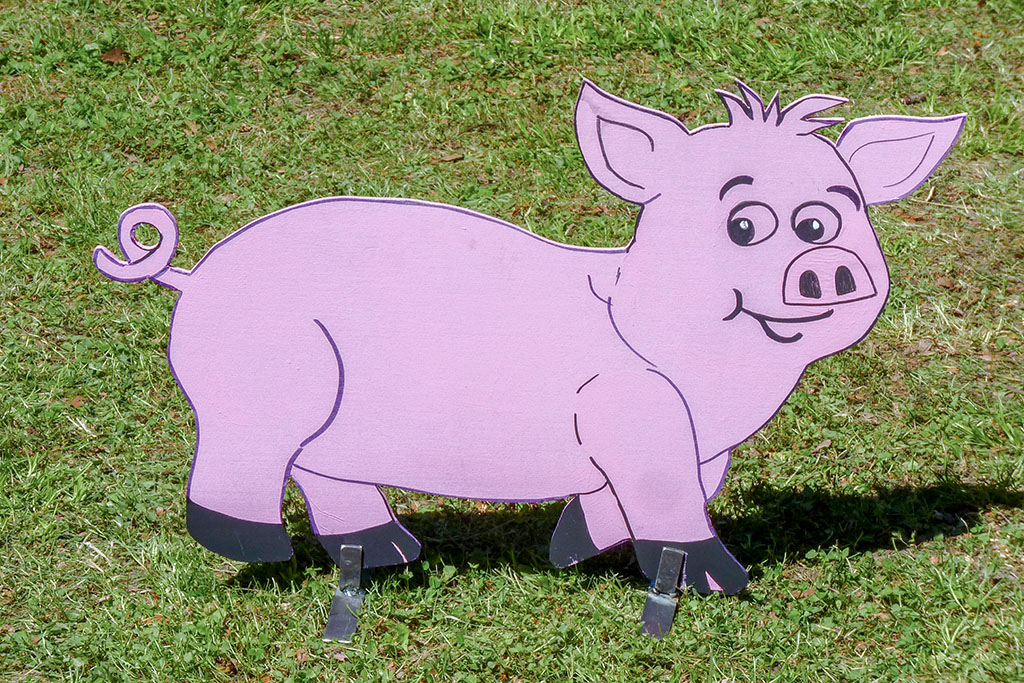
Finalement, la saint-cochon, ce n’est pas seulement une tradition rurale. C’est peut-être aussi un rappel très moderne : celui du lien entre ce que nous mangeons, ce que nous savons faire, et notre capacité à nous affranchir des grandes multinationales.
Ces temps-ci, on parle beaucoup de souveraineté ou d’autonomie : informatique, énergétique, militaire. Mais qu’en est-il de l’autonomie alimentaire ?
Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais certains pays commencent déjà à constituer des stocks alimentaires stratégiques.
A lire aussi :



